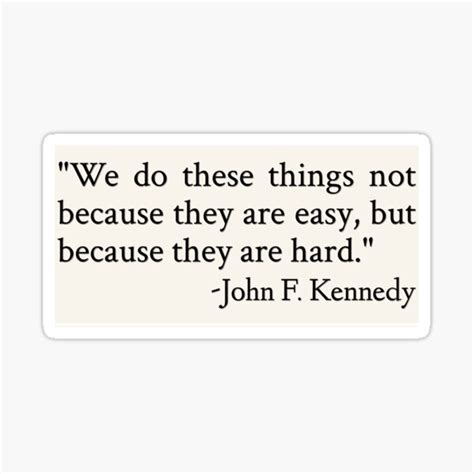[Traduction libre d'un billet de Joan Westenberg en date du 8 octobre 2025. Parce que j'ai moi aussi connu au tournant de la vingtaine une période punk No Future
.]
« Quand la croyance est-elle devenue gênante ?
Notre état d’esprit par défaut a changé ces derniers temps : du scepticisme, qui peut être sain, au cynisme, qui a tendance à corrompre tout ce qu’il touche.
Je tiens à préciser ce que j’entends par cynisme : je parle de la pensée réflexe selon laquelle les motivations déclarées par tous sont fausses, que les institutions sont irrémédiablement corrompues, que les projets idéalistes sont soit des escroqueries, soit des illusions, qu’il n’y a aucun espoir, et que quiconque prétend le contraire est soit naïf, soit complice.
L'attrait du cynisme réside dans le fait qu'il vous donne l'air intelligent sans exiger beaucoup de réflexion personnelle. Il est plus facile de démolir que de construire, d'anticiper le pire que d'évaluer les faits, de ricaner que de s'engager, de sourire en coin plutôt que de sourire tout court.
Le cynique n’est jamais gêné d’avoir cru en quelque chose qui a échoué.
Il n'est jamais pris en flagrant délit de ridicule parce qu'il avait fait confiance.
C'est une police d'assurance contre la déception, et dans un monde qui déçoit régulièrement, qui peut blâmer les gens de vouloir se protéger ?
Mais le cynisme ne vous protège de la perte qu'en vous empêchant de prendre des risques. Il vous protège de la souffrance d'un idéalisme trahi, mais il le fait en rendant impossible de croire en quoi que ce soit. »
« Le cynique atteint l'invulnérabilité en visant la stérilité. On ne peut pas être déçu par une cause à laquelle on n'a jamais cru, un mouvement auquel on n'a jamais adhéré, un homme auquel on n'a jamais fait confiance, une idée à laquelle on n'a jamais accordé une once d'attention.
George Orwell était bien placé pour le savoir. Il a passé des années à documenter les crimes du totalitarisme et les échecs des mouvements politiques, mais il n'a jamais cessé de croire que le socialisme démocratique était possible et valait la peine de se battre pour. Il était capable de garder simultanément à l'esprit le régime de Staline est monstrueux
et un système économique plus juste est réalisable
.
Ce à quoi Orwell a résisté, avec force et à contre-courant de la tendance moderne, c'est au glissement du cette chose était corrompue
vers le tout est forcément corrompu
. Sa capacité à rester idéaliste tout en étant lucide sur les faiblesses humaines est l'une des raisons pour lesquelles ses écrits restent toujours d'actualité en 2025. »
Mais le bilan historique n'est-il pas accablant ? La plupart des grands projets ne sont-ils pas des échecs ? La plupart des mouvements ne sont-ils pas récupérés, la plupart des institutions capturées, la plupart des idéalistes ne sont-ils pas démasqués comme étant des hypocrites ?
« Bien sûr.
Il existe (comme j’aime à le dire) de nombreux cas de ce genre.
La Révolution française a bel et bien dévoré ses enfants. L'Union soviétique est devenue exactement le type de tyrannie qu'elle prétendait renverser. Des politiciens qui militent pour des réformes se laissent engloutir par le système qu'ils avaient promis de changer.
Mais regardez ce qui se passe lorsque nous nous en arrêtons uniquement à cela : nous passons à côté de tous les cas où les choses ont vraiment fonctionné.
Le plan Marshall a contribué à reconstruire l'Europe. Le mouvement des droits civiques a mis fin à la ségrégation raciale. La variole a été éradiquée grâce à un effort de coordination internationale. Le Protocole de Montréal a permis de remédier au trou dans la couche d'ozone. S'agit-il de réussites parfaites ? Non, elles sont toutes le fruit d'une série de compromis douteux, d'exécutions imparfaites et de conséquences imprévues.
Mais elles se sont produites.
Et le monde est différent // meilleur grâce à elles.
Le cynique universel traite ces succès soit comme des coups de chance, soit comme de la propagande, ce qui est une position impossible à tenir. Si chaque succès apparent doit être réinterprété comme un heureux hasard ou une façade pour quelque chose de sombre et louche, vous avez rendu votre vision du monde infalsifiable. Vous avez créé une théorie qui explique tout et rien. »
« Le cynique prétend être le seul à vouloir voir le monde tel qu'il est réellement, tandis que tous les autres se complairaient dans des fictions réconfortantes. Mais c'est l'inverse. Le cynique a simplement choisi un autre ensemble d'axiomes, qui filtre tout autant la réalité que l'optimisme naïf. Si l'optimiste ne voit que le bien, le cynique ne voit que le mal, et tous deux sont aveugles à la réalité confuse, compliquée et désordonnée // foireuse qui se présente à eux.
Oui, il existe des crises de reproductibilité, des biais de publication et des incitations perverses qui récompensent les découvertes spectaculaires et ignorent le travail acharné. Le cynique s'en sert pour conclure qu'il ne faut se fier à aucune découverte scientifique, que l'expertise n'est que l'entre soi de diplômés et que l'évaluation par les pairs est un système de rémunération. Ce qui rend impossible de distinguer les domaines présentant de graves problèmes de ceux présentant des lacunes mineures, les études profondément biaisées de celles qui sont simplement imparfaites, les experts qui défendent un certain programme de ceux qui tentent de découvrir la vérité.
Quand tout est arnaque, plus rien n'est arnaque. Quand chacun est motivé par des intérêts égoïstes cachés, nous abdiquons toute capacité à distinguer une personne véritablement engagée dans le bien commun d'une personne véritablement escroc.
Le cynique pourrait dire : voyez-vous, c’est là le problème, il n’y a aucune différence.
C'est juste abandonner.
Et je ne suis pas du genre à abandonner. »
« Je soupçonne qu'une partie du cynisme moderne est due à la surcharge d'informations. Nous sommes exposés à un flot incessant d'histoires de corruption, d'échecs et de trahisons. Pour chaque témoignage réconfortant d'une association caritative faisant du bien, on compte trois révélations sur la fraude. Pour chaque intervention politique efficace, on compte dix échecs. Et tout cela est plus visible que jamais. Il est facile d'examiner ce flot d'informations et de conclure que le ratio échec/succès doit nous inciter à partir du principe que l'échec est la norme.
En tant que journaliste, croyez-moi quand je vous dit qu'il s’agit d’un problème d’échantillonnage. Les mauvaises nouvelles suscitent plus d'attention que les bonnes. Les échecs sont plus intéressants que les réussites. L’association qui distribue efficacement des moustiquaires antipaludiques depuis vingt ans fait l'objet d'un seul article ; celle qui s’effondre suite à un scandale en suscite des dizaines. Notre environnement informationnel tend à donner une image plus sombre du monde qu’il ne l’est, et le cynique est soit aveugle, soit arrogant, soit assez stupide pour prendre cet échantillon biaisé pour la réalité objective.
De plus, le cynisme agit comme un marqueur de statut social dans certaines communautés. Le merdeux capable d'expliquer pourquoi une proposition ne fonctionnera pas paraît plus intelligent que celui qui suggère qu'elle pourrait fonctionner si l'on ajustait ces trois paramètres. Et celui qui remet en question les motivations de chacun paraît plus sophistiqué que celui qui prend au pied de la lettre les intentions déclarées.
On observe alors un effet de cliquet : chaque génération d'intellectuels s'efforce d'être plus cynique que la précédente pour prouver sa supériorité. Les penseurs des Lumières ont remis en question l'autorité traditionnelle ; les romantiques ont remis en question le rationalisme des Lumières ; les modernistes ont remis en question tous les grands récits ; les postmodernistes ont remis en question la possibilité même de la vérité. Chaque étape semblait apporter une compréhension plus profonde, mais à un certain moment, la remise en question se transforme en tour de passe-passe. »
« Le cynique objectera que j'attaque un épouvantail // personne n'est vraiment cynique universel en pratique // chacun fait des exceptions pour ce qui lui tient à cœur. Et c'est en partie vrai. La plupart des personnes qui adoptent des postures cyniques sont d'un cynisme incohérent. Elles croient légitimes les causes qu'elles défendent tout en rejetant celles des autres. Elles font confiance à leurs experts préférés tout en supposant que ceux des autres sont compromis. Elles pensent que les institutions de leur camp sont fonctionnelles tout en traitant celles de l'autre camp comme irrémédiablement corrompues.
Mais le cynisme incohérent pourrait être encore pire que le cynisme universel. Il ajoute un raisonnement motivé et du tribalisme à un point de vue déjà problématique. Au moins, le cynique universel est impartial dans son mépris. Le cynique sélectif utilise simplement le cynisme comme couverture, l'appliquant quand cela lui convient et le mettant de côté lorsque ses intérêts sont en jeu.
L'optimisme pur n'est clairement pas la solution. La confiance naïve mène à l'exploitation, la foi aveugle mène au sectarisme, et l'acceptation aveugle conduit à de mauvaises décisions. »
« Quoi donc, alors ?
William James a écrit sur la volonté de croire ; dans certaines situations, croire en quelque chose peut rendre plus probable que cela devienne vrai. Autrement dit, la démocratie ne fonctionne que si les citoyens y croient et y participent en conséquence. Les communautés scientifiques ne fonctionnent que si les gens croient que l'honnêteté intellectuelle est possible et travaillent pour cela.
Le cynique répond qu'il s'agit là de raisonnements motivés, que nous croyons à certaines choses parce que nous voulons qu'elles soient vraies plutôt que parce qu'elles sont vraies. Mais les institutions, les mouvements et les normes sociales n'existent que dans la mesure où les gens y croient et agissent comme si elles sont réelles. Le cynique qui traite toutes les institutions de corrompues contribue à leur corruption en les privant de l'engagement de bonne foi qui les préserve de la corruption.
Le cynisme universel est une lâcheté morale, le refus de se risquer à investir ses espoirs dans quoi que ce soit, car cela reviendrait à admettre que l'on se soucie suffisamment de quelque chose pour prendre le risque de se tromper à son sujet. Le cynique se sent supérieur sans rien apporter, critique sans rien construire, a raison sur les échecs sans jamais risquer l'échec lui-même.
Voilà le véritable argument contre le cynisme : il protège l’ego aux dépens du monde. Il vous donne l’impression d’être intelligent tout en vous rendant confortablement inutile. Il vous protège de la déception tout en vous barrant la réussite. Et tout cela à moindre coût, à un prix défiant toute concurrence, tout en prétendant être la seule position honnête, la seule position réaliste.
Et c'est des conneries.
Voir les choses telles qu’elles sont, c’est voir à la fois les échecs et les succès, à la fois la corruption et l’intégrité, à la fois l’intérêt personnel et l’altruisme qui existent dans le monde.
L’invulnérabilité du cynique n’est en réalité qu’un autre mot pour désigner l’impuissance.
Et l’impuissance peut vous protéger de l’échec, mais elle vous garantit aussi que vous ne réussirez jamais rien à rien. »
#Madagascar #Monde
#Malagasy
#GenZ
#GenZoky
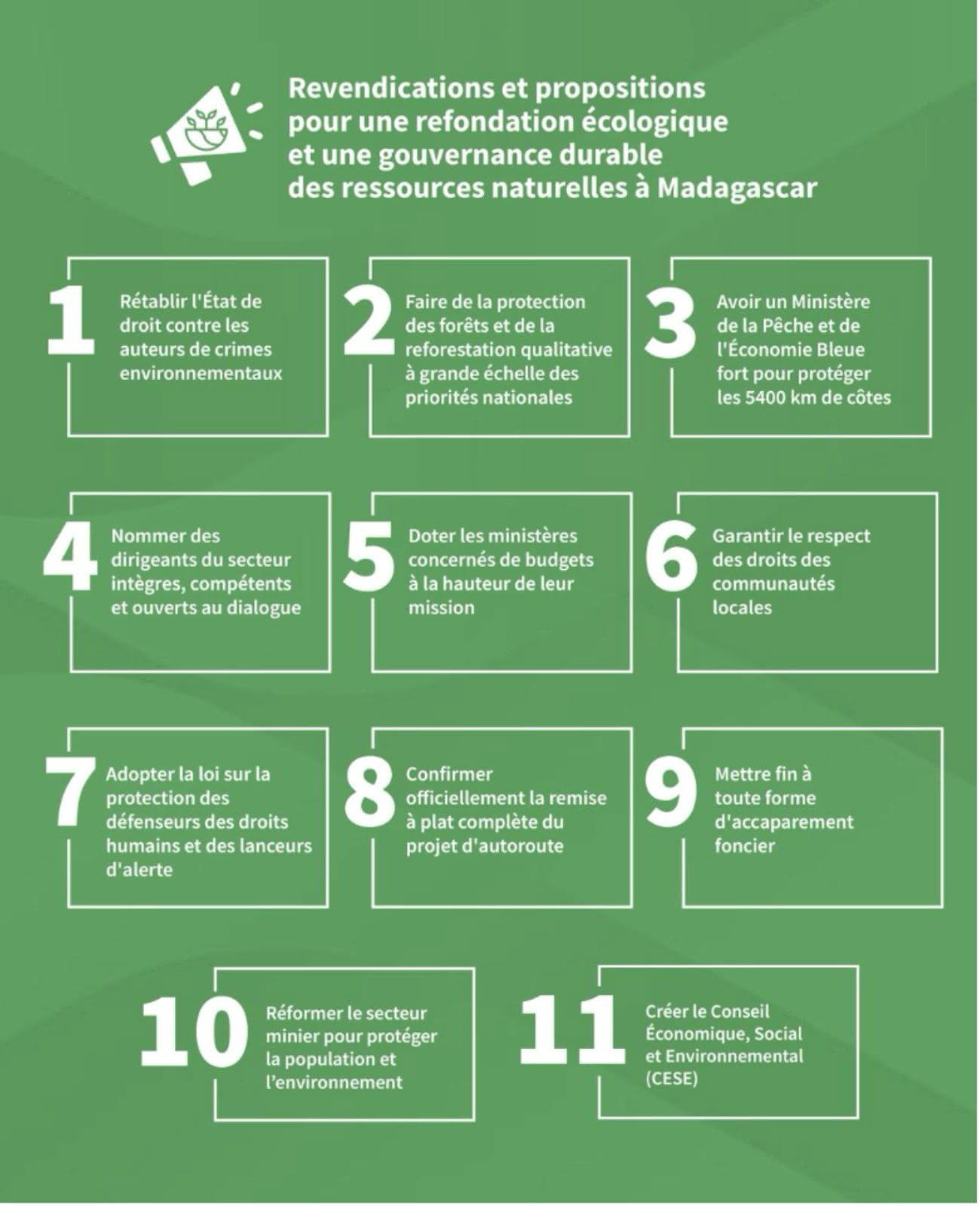
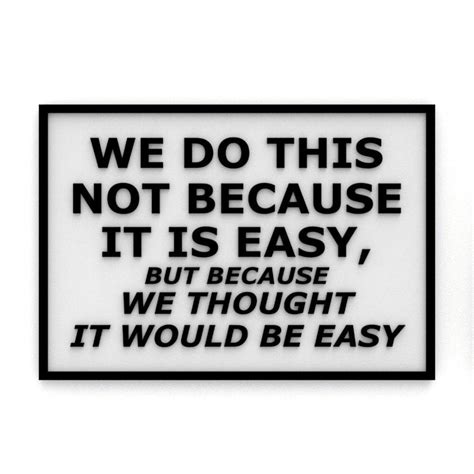 vs.
vs.