Sortie(s) de crise(s)
Suite au commentaire de dot.mg par rapport au billet précédent, je m'amuse d'une certaine confusion entre les notions de ruse et d'expérience.
Bien entendu, en prenant la décision finale d'aller à Iavoloha, j'étais (nous étions) conscient(s) que malgré les promesses reçues verbalement, il y aurait une tentative de récupération politicienne. Ayant déjà eu à aller à Iavoloha dans le passé (et dans un contexte différent), je savais également que le cadre était assez antinomique avec une vraie discussion.
Je comprends donc parfaitement les organisations qui ont choisi de ne pas y aller. Mais même si c'était infiniment plus risqué, il est paru plus cohérent de passer d'abord par la voie difficile.
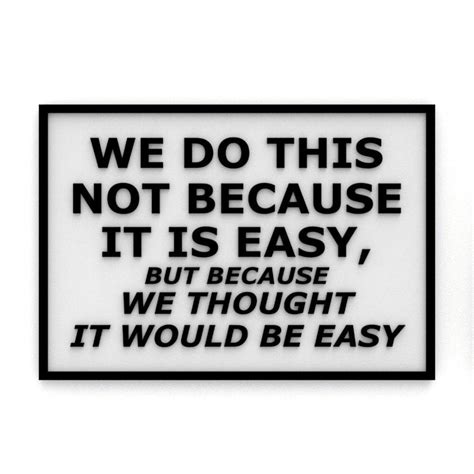 vs.
vs.
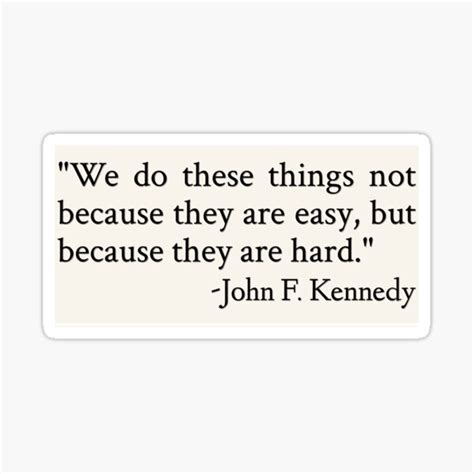
Pourquoi ? Parmi les expériences qui ont influencé ce positionnement périlleux, il y a eu celle ci-après.
Le précédent autoroute
Indri a été relativement en pointe dans l'opposition à la manière dont le projet d'autoroute Antananarivo - Toamasina a été mené. Nous nous sommes mobilisés parce que nous avions constaté sur le "Colisée" (construit mais toujours pas exploité) et sur le téléphérique (guère mieux) que les choses qui paraissent les plus délirantes et les plus improbables aux esprits rationnels peuvent néanmoins arriver à Madagascar lorsque le sésame "projet présidentiel" était prononcé.
Il fallait au moins tenter de limiter les dégâts sur ce projet d'autoroute. La communauté environnementale s'est mobilisée, mais sans grand retour des autorités. Ceux qui au niveau des communautés de terrain protestaient ont été menacés. Comme pour aujourd'hui au niveau de la GEN Z, certaines personnes se sentaient tellement en risque qu'elles ne rentraient plus chez elles et changeaient de lieu chaque nuit.
Il n'y a eu un début de prise en considération des protestations par les autorités que lorsque le tam-tam au niveau international a commencé à porter ses fruits, mais jusqu'ici nous avons encore énormément de mal à trouver le bon interlocuteur.
Bien que tout le monde savait pertinemment qu'il s'agissait d'un projet présidentiel, le pouvoir politique s'est toujours réfugié derrière quelques techniciens qui n'étaient autorisés à lâcher que quelques bribes d'information. Les rares fois où des ministres étaient présents, ils étaient en mode "paroles d'apaisement" sans grand chose de bien concret à présenter.
Bien entendu, les organisations de la société civile n'ont jamais pu rencontrer le décideur final : le Président.
Porter ne serait-ce qu'un peu de contradiction
Pour une fois que celui-ci se sentait obligé d'écouter la société civile (ou au moins de faire semblant), il m'est apparu illogique de sembler se dérober et prétendre que j'avais piscine 😉. Mais il fallait être prêt à être dans le rapport de force.
Comme évoqué auparavant, je savais déjà que le cadre et le contexte seraient assez antinomiques avec une vraie discussion. Que ce soit avant ou pendant la crise, c’est toujours un peu le même format : le Président commence par un long monologue pour justifier sa politique, et garde ensuite la maîtrise du « débat » et de la distribution de temps de parole. Ses collaborateurs quant à eux n’en placent pas une. On est à Madagascar dans toute sa dramatique verticalité…
Dans ces conditions, comme le temps est compté, lorsque tu as la possibilité de prendre la parole, tu dois aller à l’essentiel de ce que tu souhaitais dire. Comme il y a beaucoup de monde, ce sera très difficile par la suite de re-obtenir la parole, encore plus si celle-ci risque de déranger…
Parfaitement conscient qu'il y avait présentes ce samedi là beaucoup d'organisations qui ne seraient que dans le Béni-oui-oui, je me suis préparé à lever le bras en premier dès que le Président demanderait si quelqu'un souhaitait prendre la parole. Pour avoir ne serait-ce qu'une petite chance de se faire entendre, il fallait profiter de l'habituel moment d'hésitation qui arrive à ce moment là, du fait que la majorité des personnes hésitent à prendre la parole en premier…
Comme cela était prévisible, les médias publics ont largement tronqué les propos dérangeants. Comme cela était déjà prévu, nous avons pris les devants en publiant les nôtres. Afin de prendre date.
Le Président n’a pas répondu sur les violences policières (pas plus qu'à Maître Maria Raharinarinivonirina de l'ACAT Madagascar). Il a répondu à côté sur la corruption et est reparti sur les discours d’auto-justification et les belles promesses qui risquent fort de rester sans lendemains, remplacées un jour par d’autres.
Et maintenant ?
Aucun scoop donc pendant la « rencontre », ni d'ailleurs depuis, mais au moins, vita ny ala-nenina.
On sait qu'à Madagascar ou ailleurs, il faut un rapport de force pour avancer. Encore faut-il que la discussion soit posée sur de bonne bases et que le rapport de force soit sain.
Je suis convaincu qu'en de telles circonstances, la désobéissance civile pacifique est le seul véritable levier à la disposition d'une population désarmée.
Elle permet à l'ensemble de la population de continuer à participer au mouvement. Selon certains chercheurs, la participation pacifique mais désobéissante de "seulement" 3,5% de la population serait suffisante à faire tomber tout gouvernement.
Voyons voir cela.